NIS 2 : comprendre la directive européenne et ses impacts pour les entreprises
17.09.2025

Chez W hub, nous accompagnons les entreprises sur leurs projets IT les plus stratégiques. Et la cybersécurité en fait évidemment partie. Parmi les grandes évolutions réglementaires, la directive européenne NIS 2 est l’une des plus structurantes de ces dernières années. Pourtant, sa mise en œuvre en France prend du retard.
Alors, que change réellement NIS 2 ? Quels sont les risques de ce décalage ? Et surtout, comment les entreprises doivent-elles se préparer ?
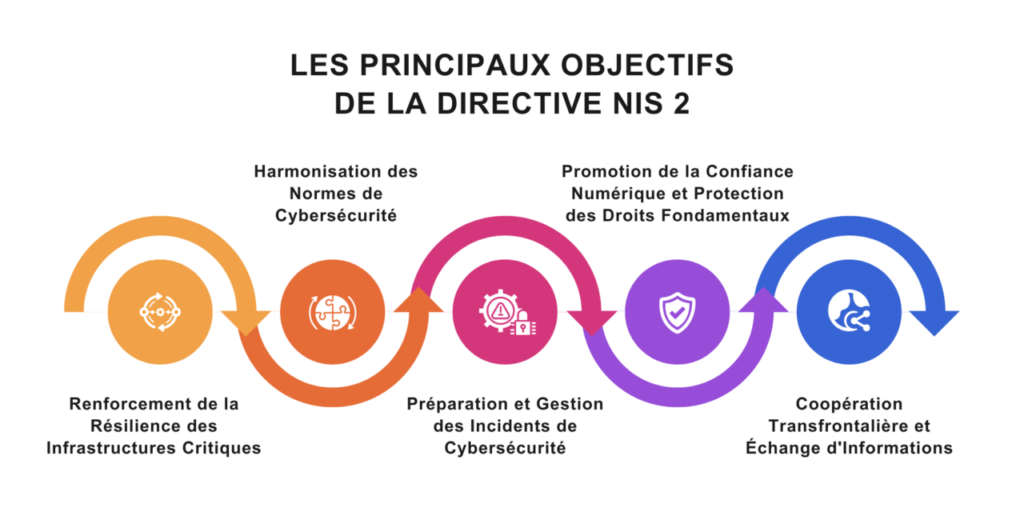
NIS 2 : de quoi parle-t-on exactement ?
Adoptée en 2022 par l’Union européenne, la directive NIS 2 (Network and Information Security) vise à renforcer la cybersécurité en Europe. Elle succède à la première directive NIS de 2016, mais avec un périmètre beaucoup plus large et des obligations renforcées.
Concrètement, NIS 2 impose aux États membres de mettre en place un cadre commun de sécurité informatique, avec trois grands objectifs :
-
Prévenir les cyberattaques grâce à des règles de sécurité plus strictes.
-
Améliorer la gestion des incidents pour limiter les impacts en cas de crise.
-
Garantir une protection homogène en Europe, afin d’éviter des écarts trop importants entre pays.
Quels secteurs sont concernés ?
La directive ne vise plus seulement les acteurs « critiques » traditionnels. Avec NIS 2, le champ s’élargit considérablement.
Deux grandes catégories sont distinguées :
-
Secteurs essentiels : énergie, transport, santé, eau, espace, finance, infrastructures numériques (cloud, data centers, DNS, TLD…).
-
Secteurs importants : services postaux, gestion des déchets, produits chimiques, agroalimentaire, fabrication de matériel informatique, fournisseurs numériques (e-commerce, marketplaces, moteurs de recherche, réseaux sociaux).
En clair : un très grand nombre d’acteurs économiques sont désormais directement concernés.
Quelles obligations pour les entreprises ?
Les organisations couvertes par NIS 2 devront appliquer des mesures strictes de cybersécurité, telles que :
-
Gouvernance et responsabilités claires : les dirigeants pourront être personnellement responsables en cas de non-conformité.
-
Gestion des risques renforcée : mise en place de politiques et de procédures pour sécuriser les systèmes critiques.
-
Obligation de notification : tout incident significatif devra être signalé aux autorités compétentes dans un délai maximum de 24 heures.
-
Audits et contrôles réguliers pour garantir la conformité.
-
Sanctions financières : en cas de non-respect, les amendes pourront atteindre jusqu’à 10 millions d’euros ou 2 % du chiffre d’affaires mondial.

Où en est la France ?
La directive devait être transposée dans les droits nationaux au plus tard en octobre 2024. Or, à l’automne 2025, la France accuse toujours un retard d’un an.
Pourquoi ?
-
Une instabilité politique qui ralentit l’agenda législatif.
-
Des contraintes budgétaires qui limitent les moyens pour accélérer la mise en conformité.
-
Un Parlement saturé de réformes prioritaires, reléguant la cybersécurité au second plan.
Résultat : les entreprises françaises évoluent dans une zone grise réglementaire, avec une visibilité réduite sur leurs futures obligations.
Quels risques pour les entreprises ?
Ce retard ne signifie pas que les entreprises ne doivent rien faire. Au contraire :
-
Les cyberattaques continuent de progresser, sans attendre que les textes soient votés.
-
Les clients et partenaires européens peuvent exiger une conformité anticipée.
-
Les dirigeants restent exposés à des risques réputationnels et financiers en cas d’incident majeur.
En clair : ne pas anticiper, c’est prendre un retard supplémentaire.
